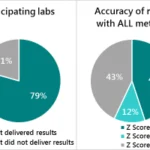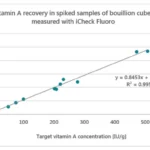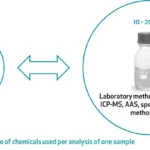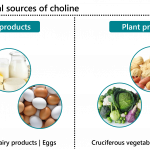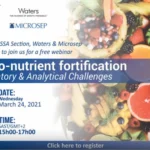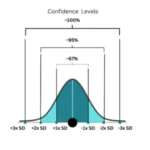La croissance démographique, l’urbanisation et la prospérité entraîneront une demande mondiale de nourriture en général et de protéines animales dans les décennies à venir. Et maintenant, après tous les défis concernant la sécurité alimentaire, en particulier pour les pays du Sud, l’Organisation mondiale de la santé a averti que la guerre en Ukraine pourrait déclencher une crise alimentaire mondiale « extrêmement grave ». Ce sujet devient chaque jour plus urgent. La Russie et l’Ukraine ont exporté au total 25,4 % du blé mondial, et l’Afrique importe environ la moitié de cet approvisionnement en blé. Toutes les exportations de denrées alimentaires ont cessé en Ukraine et la guerre mettra fin à la production alimentaire cette année. Indépendamment de ces développements, on estime que la demande mondiale de protéines animales augmentera de 75 % au cours des quatre prochaines décennies. Cette demande accrue pose des défis importants aux pays en développement et aux pays industrialisés et rend impérative la recherche de sources de protéines alternatives.
Grâce à leur teneur élevée en protéines de haute qualité, les insectes comestibles peuvent contribuer de manière significative à la sécurité alimentaire mondiale. En outre, ils sont riches en vitamines, en minéraux et/ou en graisses et représentent donc une alternative riche en nutriments aux sources de protéines animales conventionnelles. Par conséquent, l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) doit absolument relever ces défis d’un point de vue nutritionnel, économique et environnemental. En outre, alors que les insectes sont actuellement collectés principalement de manière opportuniste, leur taux de reproduction rapide et leurs conditions de vie relativement simples ont le potentiel de transformer l’élevage en une production économique contrôlée et durable. Dans l’élevage d’insectes, les émissions de gaz à effet de serre sont plus faibles, l’efficacité de la conversion des aliments est bonne et les zones de production sont plus petites que celles des élevages conventionnels, tels que les porcs et les bovins. Ces avantages font de l’élevage d’insectes une source alimentaire à faible impact environnemental. Un autre aspect écologique intéressant est la possibilité d’utiliser le flux de déchets, tels que les restes de nourriture. Cela signifie qu’un système durable en boucle fermée avec un équilibre environnemental favorable est, en principe, possible.
L’entomophagie, c’est-à-dire la consommation d’insectes par l’homme, est connue depuis des milliers d’années. En Asie, en Afrique et en Amérique latine notamment, plus de 1900 espèces d’insectes différentes, dont des coléoptères, des chenilles, des abeilles, des guêpes et des fourmis, sont consommées par environ deux milliards de personnes. Les insectes constituent un complément essentiel aux aliments de base riches en glucides mais pauvres en protéines, tels que le riz, les céréales, les pommes de terre et le manioc, en particulier dans les pays en développement. Ce qui fait partie du régime alimentaire normal d’environ un tiers de la population mondiale en Asie et en Afrique est généralement considéré comme un tabou alimentaire pour l’Europe et les États-Unis en raison des aversions existantes. Cependant, l’utilisation de farines d’insectes dans l’alimentation offre la possibilité d’améliorer l’acceptation des consommateurs. En outre, les insectes peuvent être utilisés dans l’industrie de l’alimentation animale, notamment dans l’aquaculture et la production de volailles.
L’utilisation d’insectes présente de multiples avantages pour assurer l’approvisionnement en protéines et en nutriments de l’avenir. Outre les avantages écologiques déjà décrits, d’un point de vue nutritionnel et médical, il y a la valeur nutritionnelle comparativement élevée et le faible risque de transmission de zoonoses, et d’un point de vue économique, il y a la possibilité de créer des chaînes mondiales durables autour des nouvelles sources alimentaires.
Collaborateur : Professeur Florian J. Schweigert